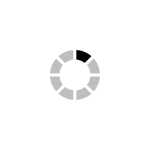La volonté de développer une ZAC à la place de l’ancien aérodrome de Brive-Laroche, par la communauté d’agglomération de Brive-la-Gaillarde, a conduit à la découverte d’un site du Paléolithique moyen situé à la confluence entre la Corrèze et la Vézère et réparti sur deux secteurs référencés Nord et Sud.
Les séries du Paléolithique s’insèrent dans des dépôts de couverture colluviaux masquant deux replats alluviaux formés à la fin du Pléistocène moyen. Ces colluvions limoneuses ont supporté deux longues phases de pédogénèse aboutissant à la formation, au sommet, d’un horizon argilique jaunâtre à fentes blanchies (unité Lsc) et à la base, d’un horizon argilique brun vif (unité Lb), tronqué à son sommet. Dans le secteur Nord, la nappe de mobilier s’insère dans Lb alors que dans le secteur Sud, elle se subdivise localement en deux niveaux : autour de l’interface entre Lsc et Lb (niveau supérieur ayant fourni l’essentiel des pièces lithiques) et à la base de Lb (niveau inférieur). Le mobilier a subi une histoire taphonomique complexe, en partie contrainte par l’existence de deux dépressions chenalisantes, chacune en position distale des nappes de mobilier. Les datations des feldspaths potassiques du sédiment par luminescence permettent de caler l’âge des formations incluant les séries paléolithiques entre 110 ± 10 ka et 71 ± 7 ka, soit sur une fourchette maximale d’environ 56 ka couvrant une grande partie du MIS 5 et la première moitié du MIS 4. Les dates effectuées au cœur des nappes d’objets permettent d’affiner l’attribution chronologique aux sous-stades MIS 5c à MIS 5a (94 ± 10 ka, 94 ± 9 ka, 92 ± 10 ka, 83 ± 9 ka).
Le mobilier lithique est majoritairement produit à partir des ressources locales, sous forme de galets de quartz provenant des alluvions de la Corrèze ou de la Vézère. Ces modules sont débités selon des systèmes unifaciaux, S.S.D.A., bipolaire sur enclume, Discoïde et plus rarement sur face inférieure d’éclat. Ils sont également utilisés comme percuteur ou enclume. Le façonnage est rare, destiné à la production d’outils lourds à partie active rectiligne ou punctiforme. S’ajoute dans le secteur Sud le recyclage de nucléus en percuteurs ou de percuteurs en nucléus ainsi que la production d’outils sur éclat avec encoches latérales ou distales. L’autre partie de la production est en silicites (32 % pour le secteur Nord ; 19 % pour le Sud), importées sur le site principalement sous forme de gros éclats matrices. Les récoltes s’effectuent majoritairement dans la moyenne vallée de la Vézère, dans l’interfluve Vézère-Dordogne notamment sur le plateau de Tamniès et dans la vallée de la Tourmente. L’approche gîtologique démontre que les récoltes ont essentiellement lieu dans des altérites affleurant sur les plateaux et permet de relativiser le caractère préférentiel des vallées dans l’accession au bassin de Brive. La production sur les silicites est réalisée selon des méthodes Kombewa, Levallois récurrentes ou linéales, Discoïde et dans de rares cas S.S.D.A. Les produits sont transformés en une large gamme de racloirs latéraux, doubles, convergents ou transversaux. Quelques marques d’usage permettent d’identifier le raclage de la peau, mais aussi de matériaux semi-durs ou durs avec les tranchants d’angles élevés. De rares tranchants d’angles plus fermés ont été utilisés pour scier un matériau dur.
Le site de Brive-Laroche aérodrome présente donc un mobilier archéologique diagnostic du Paléolithique moyen récent. A l’échelle locale, la dichotomie claire des modes de production en fonction de la matière première le rapproche de bon nombre de sites du Quercy, comme le Mas Viel, Les Fieux couche Ks, ou encore Pradayrol. A une échelle plus globale (grand Sud-Ouest de la France) les caractéristiques des séries lithiques conduisent à leur rattachement à un techno-complexe moustérien mixte. La variabilité des comportements techniques doit toutefois, dans le cas de Brive-Laroche aérodrome, être mise en perspective avec la superposition des occupations a minima dans le secteur Sud.
INTERVENANTS :
Aménageur : SPL Brive et son Agglomération
Prescripteur : DRAC – SRA Nouvelle-Aquitaine
Opérateur : Paléotime
AMÉNAGEMENT :
ZAC Brive-Laroche
LOCALISATION :
RAPPORT FINAL D’OPÉRATION :
Référence bibliographique :
VIALLET C. (dir.), AJAS PLANTEY A., BERNARD-GUELLE S., DELVIGNE V., FERNANDES P., GAUVRIT-ROUX E., LAHAYE C., LEBRUN B., MATHIAS C., MONIN G., NAVENNEC G., PLATEL J.-P., PIBOULE M., RAYNAL J.-P., ROBBE J., RUÉ M., TALLET P., TURQ A., Une nouvelle occurrence du Paléolithique moyen en Corrèze : les occupations du site de Brive-Laroche aérodrome (Brive-la-Gaillarde/Saint-Pantaléon-de-Larche), Rapport Final d’Opération, Villard-de-Lans : Paléotime, 362 p.